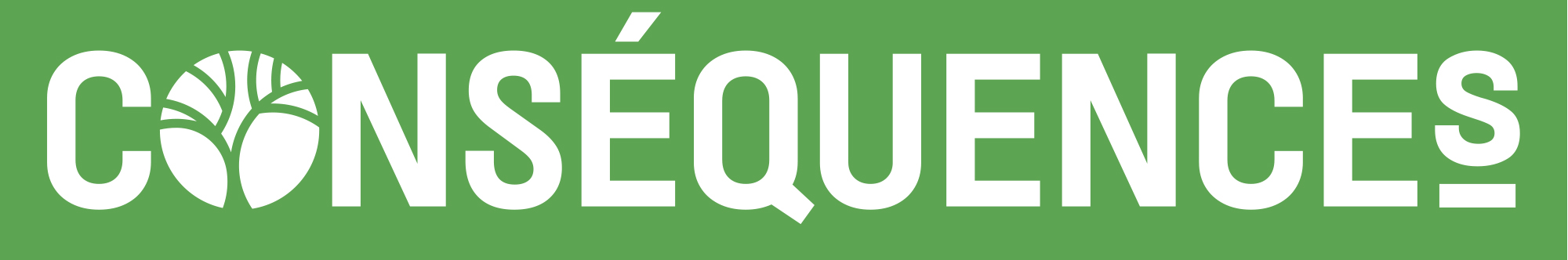Les Pépites de la ruralité : des communes rurales et leurs élus agissent pour une transition au services des habitants
Dans un contexte où les territoires ruraux sont en première ligne des impacts du changement climatique, l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) et l’association Conséquences lancent une campagne nationale pour valoriser les initiatives locales en faveur de la transition.
Avec le Trophée des Pépites de la Ruralité, l’objectif est clair : montrer que les petites communes, leurs élus et maires innovent, s’adaptent et construisent des solutions concrètes pour répondre aux défis environnementaux. Ce projet, mené en partenariat avec plusieurs associations départementales de maires ruraux, vise à donner de la visibilité aux élus qui portent des projets ambitieux, tournés vers l’avenir et bénéfiques pour leurs habitants.


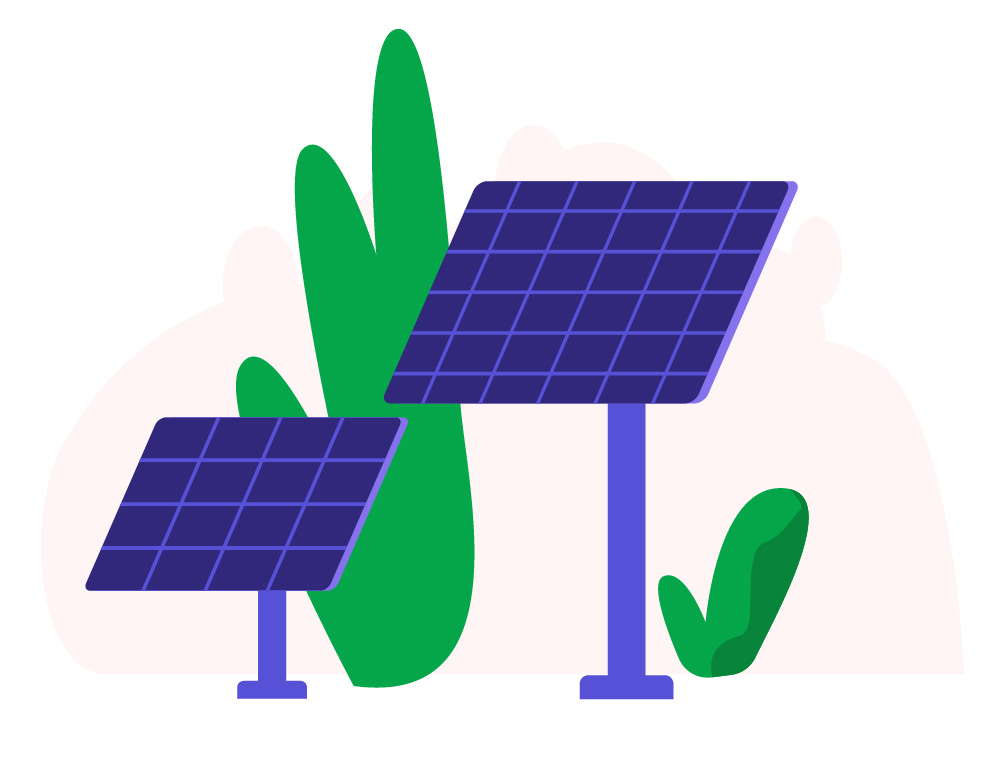
Un projet pour inspirer et amplifier la transition rurale
Circuits courts et ventes directes, énergies renouvelables, rénovation énergétique, restauration d’espaces naturels, mobilités douces, agriculture durable, gestion de l’eau ou adaptation à un climat qui change trop vite : les initiatives locales ne manquent pas. Pourtant, elles restent souvent méconnues. À travers des vidéos reportages de terrain, des articles et des actions de sensibilisation via les réseaux sociaux ou les médias locaux, ce projet entend mettre en avant des exemples concrets et réplicables qui participent à la résilience des territoires.
Chaque département impliqué sélectionnera plusieurs projets menés par des maires et les élus locaux avec les habitants. Trois d’entre eux seront mis en avant à travers un reportage vidéo, diffusé sur les réseaux sociaux et auprès des élus locaux.
En parallèle, des événements seront organisés pour favoriser les échanges entre élus et acteurs locaux, autour des impacts locaux du changement climatique et des solutions possibles. L’idée est aussi de démontrer que la transition peut être un levier de développement pour les communes rurales.

Un trophée national pour récompenser l’engagement rural
Le point d’orgue de cette campagne sera l’élection des projets les plus marquants dans trois catégories :
– social et démocratie locale : le projet favorise le vivre-ensemble, les échanges et le partage
– économique : le projet a des retombées économiques tangibles pour la commune, son budget, ses habitants ou un acteur économique local
– environnemental : le projet permet de répondre durablement à une problématique environnementale (eau, biodiversité, etc.)
Le vote sera proposé en septembre aux 13 500 communes adhérentes de l’AMRF. En septembre 2025, les élus voteront pour la « Pépite de la Ruralité », les trophées seront remis lors du Congrès annuel des maires ruraux, au Palais des Congrès du Futuroscope le week end du 28 septembre.

Donner la parole aux territoires ruraux en action
Au-delà d’une simple reconnaissance, ce projet veut montrer la place centrale que les communes rurales occupent dans la transition et l’adaptation au changement climatique. Les territoires ruraux sont en première ligne face aux changements climatiques et savent, avec des moyens souvent limités, innover et s’adapter.
À travers cette campagne, Conséquences et l’AMRF souhaitent créer une dynamique, donner envie à d’autres élus d’agir et montrer que les réponses aux enjeux climatiques peuvent aussi avoir beaucoup de cobénéfices pour les habitants.
Ordan-Larroque : l’énergie solaire au service du village
À Ordan-Larroque, dans le Gers, la transition énergétique prend une dimension concrète avec l’installation d’ombrières photovoltaïques. Sous l’impulsion du maire Jean-Claude Le Maire, ce projet vise à renforcer l’autonomie énergétique de la commune tout en apportant un bénéfice immédiat aux habitants.
« Nous avons voulu une solution qui serve à la fois l’intérêt collectif et l’avenir énergétique de notre territoire », explique le maire. En couvrant des parkings avec des panneaux solaires, la commune produit de l’électricité renouvelable, réduit sa facture énergétique et offre aux usagers des espaces ombragés, un atout non négligeable dans cette région ensoleillée.
Au-delà des économies réalisées, ce projet s’inscrit dans une volonté plus large de préserver les ressources locales et d’ancrer Ordan-Larroque dans un modèle plus durable.
Miélan : Miser sur des cultures adaptées pour préparer l’avenir
À Miélan, le maire Jean-Loup Arenou et l’agriculteur Cédric Larrieu ont fait le choix de l’anticipation. Face aux changements climatiques qui transforment les conditions de production agricole, ils expérimentent des cultures mieux adaptées aux nouvelles réalités du territoire. En introduisant des espèces comme le caroubier et l’olivier, plus résistantes aux sécheresses, ils ouvrent la voie à des alternatives viables pour les agriculteurs locaux.
Ce projet, mené avec l’appui de Yannick Masmondet (Oliv’Green), dépasse la simple expérimentation. Il pose la question centrale de l’adaptation des filières agricoles dans des zones rurales soumises à des pressions climatiques croissantes. Pour les élus comme pour les agriculteurs, l’enjeu est clair : sécuriser l’activité économique tout en valorisant des productions à forte valeur ajoutée.
La vidéo illustre surtout une réalité : l’adaptation n’est plus une option, mais un levier stratégique pour les territoires ruraux.
Termes d’Armagnac : circuits courts et qualité alimentaire en Ehpad
À Termes d’Armagnac, le maire Thibault Renaudin mise sur les circuits courts pour améliorer l’alimentation des résidents de l’Ehpad communal. Grâce à un approvisionnement en produits bio et locaux, ce projet renforce l’agriculture de proximité tout en garantissant des repas de qualité, préparés sur place par un cuisinier.
Au-delà des bénéfices nutritionnels, cette démarche illustre une volonté politique : soutenir les producteurs locaux, dynamiser l’économie rurale et offrir aux aînés une alimentation plus saine et savoureuse. Une approche qui prouve que transition alimentaire et attractivité des territoires peuvent aller de pair.
La vidéo témoigne de l’intérêt croissant pour ces modèles vertueux qui allient engagement communal et réponses concrètes aux défis agricoles et sociaux.
Lagardère : un village fleuri qui mise sur la qualité de vie
La commune de Lagardère s’inscrit depuis de nombreuses années dans la dynamique du label « Villes et Villages Fleuris », qui récompense les initiatives locales en faveur de l’embellissement, de l’environnement et du cadre de vie. Lors de la dernière édition du concours, organisée par le Conseil départemental du Gers, 24 communes labellisées (niveau régional) ont été mises à l’honneur et 29 distinguées au niveau départemental, témoignant de l’engagement croissant des territoires ruraux pour la valorisation de leurs espaces publics.
À Lagardère, ce projet s’est traduit par l’aménagement paysager des rues du village et des abords de la mairie, avec une intégration harmonieuse du végétal dans l’espace public. Pour le maire de la commune, Patrick Dubos « Au-delà de l’aspect esthétique, notre démarche de fleurissement s’inscrit dans une volonté de valoriser notre patrimoine naturel et d’encourager une gestion durable de nos espaces verts. Le label est une belle récompense pour cet engagement ».
Comme le souligne Laetitia Laffitte, Chargée d’études Paysagiste au CAUE de Gers et animatrice du label au niveau du département (le département ayant donné cette mission au CAUE 32), « l’obtention de ce label est un témoignage de reconnaissance qui contribue à l’attractivité des communes. » Une distinction qui prouve que l’amélioration du cadre de vie n’est pas réservée aux grandes villes, mais qu’elle est aussi une priorité pour les petites communes engagées dans la préservation de leur identité et de leur environnement.

Rénovation d’école : Souvigné-sur-Sarthe mise sur l’avenir durable !
À Souvigné-sur-Sarthe (606 habitants), la rénovation énergétique de l’école municipale est une illustration de l’engagement fort de la maire Mélanie Cosnier et de son équipe pour préserver le patrimoine communal tout en s’adaptant aux défis climatiques et en faisant des économies d’énergie.
Grâce au soutien du programme Leader et du Pays Vallée de la Sarthe, cette école a bénéficié d’une transformation exemplaire : remplacement de la vieille chaudière fioul par un modèle à granulés de bois, isolation en fibre de bois, VMC double flux et éclairage LED. Un chantier ambitieux de 395 000 €, marqué par des choix techniques écologiques et durables.
Malgré les travaux, l’école a continué d’accueillir ses 38 élèves, illustrant la capacité des communes rurales à innover sans renoncer à leur mission éducative. Aujourd’hui, élèves et enseignants profitent d’un cadre plus confortable et économe en énergie.
En parallèle, la commune a modernisé son éclairage public, réduisant de 50 % la consommation énergétique du village.
« Ce projet incarne la détermination des élus ruraux à conjuguer tradition et modernité, en investissant dans un avenir où le bon sens local et la gestion responsable des ressources façonnent une ruralité durable et vivante, » affirme Mélanie Cosnier, maire de Souvigné-sur-Sarthe.
Solesmes : un marché au cœur du terroir
À Solesmes (1 230 habitants), le marché du mercredi matin est devenu un véritable pilier de la vie locale. Initié par la municipalité, il répond à une double ambition : dynamiser la commune et valoriser une alimentation ancrée dans le terroir.
« Nos campagnes sont riches de savoir-faire et de produits de qualité. Ce marché est un moyen de les faire vivre et de renforcer le lien entre producteurs et habitants », explique le maire, fier de cette initiative qui favorise les circuits courts et l’économie locale.
Face à son succès, le marché est situé sur la place Cécile-Bruyère, offrant un cadre agréable et aéré. Producteurs et artisans locaux s’y retrouvent chaque semaine.
Bien plus qu’un simple lieu d’échange, ce marché incarne l’âme rurale de Solesmes. Il illustre comment une commune peut, à son échelle, encourager une consommation plus responsable et préserver son patrimoine agricole et gastronomique, tout en créant un moment de convivialité pour ses habitants.
Rahay : Quand les habitants prennent leur avenir énergétique en main !
À Rahay, une petite commune de 165 habitants en Sarthe, la transition énergétique n’est pas un simple concept, mais une réalité concrète portée par la maire Isabelle David et son adjointe Sylvie Pasquier. Conscientes de l’importance d’assurer l’avenir énergétique de leur village, elles ont soutenu avec conviction un projet collectif ambitieux : l’autonomie énergétique grâce à l’énergie solaire.
Tout a débuté lors d’une réunion publique sur la résilience communale, où l’expérience d’un habitant ayant rendu sa maison autonome à 80%, a servi d’étincelle. Séduite par cette approche pragmatique et locale, Isabelle David a rapidement mobilisé la municipalité pour accompagner cette initiative citoyenne.
Aujourd’hui, 19 familles de Rahay participent à ce projet collectif, leur permettant d’accéder à des installations photovoltaïques à des tarifs avantageux. L’objectif est clair : atteindre jusqu’à 80 % d’autonomie énergétique et alléger significativement les factures des foyers.
« Dans nos villages, il faut être pragmatique. Ce projet, c’est du concret : il permet aux habitants de reprendre la main sur leur consommation et d’assurer l’avenir énergétique de notre territoire, » souligne Isabelle David, la maire de Rahay.
Le coût des installations varie selon les besoins, allant de 6 000 à 7 000 € pour une installation de 3 kWc à 16 000 à 18 000 € pour 9 kWc. La municipalité a joué un rôle essentiel, allant au-delà de l’encouragement, en assurant la coordination et l’accompagnement des habitants, notamment sur les aspects financiers.
Avec ce projet novateur, Rahay s’affirme comme un village pionnier de la transition énergétique en milieu rural. Une belle démonstration que les maires ruraux sont des acteurs clés de l’adaptation au changement climatique.
Louplande : la commune se prépare pour 2050
Depuis quelques années, la commune de Louplande fait figure d’exemple en matière de modernisation des équipements publics. Le conseil municipal a engagé la rénovation thermique de ses bâtiments, s’inscrivant ainsi dans les objectifs nationaux de décarbonation du secteur tertiaire à horizon 2050. Appuyée par de nombreux financements publics et le soutien précieux de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, la commune a initié les réflexions dès 2020.
La transformation de Louplande a débuté par le groupe scolaire Mozart, qui a échangé sa chaudière à gaz contre une pompe à chaleur sur sondes géothermiques. Double vitrage, isolation des plafonds, VMC double flux et panneaux photovoltaïques en autoconsommation : autant d’aménagements pour atteindre une réduction drastique des dépenses communales en énergie. “Malgré les difficultés rencontrées, raconte le maire Noël Tellier, nous sommes fiers des travaux réalisés. Louplande sera prête en 2050 !”
Prochaines étapes, rénover la Maison du Temps Libre et le restaurant scolaire dans un second temps. Comme pour le groupe scolaire, la commune souhaite impliquer les associations, les riverains dans la construction du projet pour s’assurer que les aménagements répondent aux attentes des usagers. Pour Noël Tellier, la transformation de Louplande est le signe que même une commune de 1500 habitants peut s’adapter aux enjeux du 21ème siècle.

Les mares de La Saucelle : un rempart oublié contre les inondations ?
La Saucelle, dont le nom latin signifie « lieu planté de saules », révèle un lien étroit entre son histoire et ses mares. Ces zones humides, véritables mailles du territoire et d’une richesse écologique exceptionnelle, sont pourtant menacées. La commune, choisie en 2021 pour le programme régional « Objectif Mares », a mis en lumière l’importance de ces écosystèmes.
Il y a mille ans, un réseau hydraulique ingénieux collectait toutes les eaux pour alimenter leurs moulins. Ces mares, autrefois indispensables à la collecte des eaux pluviales et à l’élevage, constituent un héritage précieux.
Le 21 mai 2024, La Saucelle a subi sa première inondation. Cet événement a révélé l’importance cruciale de nos mares, autrefois négligées, comme systèmes de protection naturels. » explique Philippe Penny, maire de la commune. « Nous avons décidé d’agir. » Le programme « Objectif Mares », soutenu par la région Centre-Val de Loire, vise à restaurer ces écosystèmes. À La Saucelle, une mare privée a été restaurée par Eure et Loir Nature, offrant un exemple concret de cette démarche et les conseils nécessaires aux propriétaires pour préserver la biodiversité locale. Les mares de La Saucelle, témoins d’un passé millénaire, se révèlent être des alliées précieuses pour l’avenir.
L’épicerie solidaire de Chapelle-Royale : un modèle de dynamisme local
Chapelle-Royale, un village de 330 habitants, a ouvert il y a 17 ans la première épicerie communale de France, portée par son maire, Thomas Blonsky. Ce commerce de proximité offre des produits du quotidien, en partenariat avec des producteurs locaux, favorisant les circuits courts et réduisant ainsi les distances de transport. L’épicerie, qui fait aussi office d’agence postale, est devenue un véritable lieu de rencontre pour les habitants.
L’initiative a été complétée par la création d’un bar-restaurant, d’un espace coworking et d’un salon de coiffure solidaire, renforçant les liens sociaux. Le village a également développé des services périscolaires et des activités pour les enfants, attirant de nouvelles familles.
Chapelle-Royale se transforme ainsi en un village dynamique et solidaire, bientôt labellisé « Village d’Avenir », un exemple de renouveau rural réussi.
Frazé : un tiers-lieu peut-il redynamiser un village ?
À Frazé, l’ancienne boulangerie a trouvé une seconde vie avec La Passerelle, un espace intergénérationnel et polyvalent. Rachetée en 2016 par la municipalité après des années d’abandon, elle a été entièrement rénovée pour devenir un lieu d’animations, d’échanges et de travail partagé. « Il fallait lui redonner une fonction au service du village », explique la l’adjointe au maire Brigitte Pistre qui a suivi le projet depuis le commencement.
En avril 2024, une agence communale de La Poste a intégré La Passerelle, une première en Eure-et-Loir pour un tiers-lieu. « C’est une expérimentation sur trois ans pour assurer une meilleure couverture du territoire. Ce service public de proximité limite les déplacements et renforce l’attractivité du village. », précise Cécilia Cavallini, employée de La Passerelle.
Avec son espace de coworking, sa salle d’activités et désormais un point Poste, La Passerelle favorise le maintien des services en milieu rural et répond aux enjeux d’aménagement du territoire. Un modèle à suivre pour revitaliser d’autres communes ?
À Janville, des voiles d’ombrage contre la chaleur : « On s’adapte, même à petite échelle »
À Janville, petite commune en Beauce de 2500 habitants en prise comme tant d’autres avec les effets du changement climatique, la mairie a fait un choix simple mais symbolique : installer des voiles d’ombrage à l’entrée de son bâtiment administratif pour lutter contre les fortes chaleurs.
« Les secrétaires me demandaient une climatisation, mais je voulais une solution plus sobre. Il y a peu d’ombre dans la cour, on ne peut pas planter d’arbres, alors j’ai cherché des alternatives. Et j’ai trouvé cette idée dans un reportage sur les îlots de chaleur en ville », raconte Stéphan Maguet, le maire de Janville.
Installées au printemps 2024 pour un coût de 10 000 € financé sur le budget communal, ces trois voiles filtrent la lumière et apportent un peu de répit en été. Si leur impact sur la température intérieure reste modeste, elles incarnent une volonté locale d’adaptation.
«Même si l’été dernier a été relativement doux, installer ces voiles est un investissement d’avenir. Ils nous aideront à mieux traverser les fortes chaleurs à venir.», affirme l’élu.
En parallèle, plusieurs producteurs locaux ont amorcé une transition vers la vente en circuit court, renforçant la résilience alimentaire du territoire. Une illustration concrète de ce que peut être l’adaptation dans les zones rurales : pragmatique, progressive, et portée par ceux qui vivent les changements au quotidien.

Vieuvicq : en route vers l’autonomie énergétique
Alors qu’elle ne compte que 450 habitants, la commune de Vieuvicq est bien décidée à investir dans la transition énergétique, au service de ses habitants. Depuis l’inauguration de l’ombrière photovoltaïque en 2023, la commune a un cap clair : parvenir à satisfaire intégralement ses besoins énergétiques par sa propre production d’électricité.
Cette première étape a débuté en 2021 par une longue phase d’études préalables, suivie de travaux, pour une mise en service en 2023. Ce nouvel ouvrage couvre aujourd’hui une consommation équivalente à celle de 50 habitants, tout en accueillant et abritant le marché de producteurs locaux ainsi que des expositions. Les ombrières sont des ouvrages d’adaptation pertinents face à l’intensification des intempéries ou des vagues de chaleur, due au changement climatique.
Pour mener à bien ce projet, le maire Philippe Morelle a pu compter sur le soutien de l’Etat, du département de l’Eure-et-Loir. Quant au financement, il a été pris en charge à 75% par la société Val de Loire Solaire. Porté par cette belle réalisation, le maire envisage d’implémenter de nouveaux panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes, poursuivant ainsi l’objectif de production d’énergie renouvelable de la commune.

Le chanvre dans la Loire : du savoir-faire oublié à la filière de demain
Dans le Roannais et le Forez, une initiative ambitieuse vise à faire renaître une culture oubliée : le chanvre. Cultivé dans la région au XVIIIe siècle, cette plante aux multiples atouts revient aujourd’hui au cœur d’une stratégie de relocalisation économique et écologique.
« Nous souhaitons redévelopper une filière qui émane du territoire. Autrefois, on cultivait du chanvre ici. Il s’agit aujourd’hui de reconquérir cette culture, et de relocaliser toute une chaîne de valeur autour d’elle. Pour que le modèle économique soit viable, il faut penser la filière dans sa globalité. C’est pourquoi nous travaillons à la fois sur les usages textiles et les débouchés dans le BTP. », explique René Valorge, maire de Saint-Denis-de-Cabanne, et président de la Communauté de communes de Charlieu – Belmont.
Portée par un réseau d’acteurs locaux – agriculteurs, Chambre d’agriculture, communautés de communes rurales, Les Tissages de Charlieu, la fédération du BTP de la Loire et l’association AURA Chanvre – la démarche vise à reconstruire une filière complète, de la graine à l’usage, en misant sur la coopération et l’expérimentation.
Le chanvre présente de nombreux atouts : il pousse rapidement, consomme peu d’eau, ne nécessite ni pesticide, ni engrais, et améliore la structure des sols. Il offre ainsi une réponse concrète aux défis actuels de l’agriculture durable.
Dans le cadre de l’expérimentation :
- Une douzaine d’agriculteurs volontaires se sont engagés dans la relance de cette culture. La première récolte, issue de 17,5 hectares semés en 2024, a été mise en bottes et est actuellement stockée. Une seconde est prévue pour 2025. Les communautés de communes accompagnent les agriculteurs en finançant chaque année les semis et le travail réalisé.
- En parallèle, la question clé de la transformation fait l’objet de travaux de recherche : des essais de filature sont menés pour valoriser les fibres textiles (≃ 25 % de la plante), tandis que le reste de la biomasse fait l’objet de tests pour la production d’isolants biosourcés destinés au bâtiment.
L’objectif à moyen terme est de parvenir à 350 hectares de chanvre cultivés chaque année, pour alimenter à la fois les filières textile et BTP. Les Tissages de Charlieu, moteurs du projet, souhaitent ainsi fabriquer des vêtements à partir de fibres locales. Pour cela, il faut garantir un approvisionnement régulier, former les agriculteurs et développer un outil industriel adapté.
Cette expérimentation illustre la force d’un projet ancré dans son territoire, où innovation, écologie et coopération locale convergent pour bâtir une filière d’avenir autour d’une culture ancestrale dont le savoir-faire s’était perdu.
À Saint-Victor-sur-Rhins, des haies pour soutenir l’agriculture et restaurer le vivant
À Saint-Victor-sur-Rhins (Loire), la haie redevient un atout pour l’agriculture et la biodiversité. En revalorisant ces éléments essentiels du paysage rural, un temps déconsidéré, la commune engage un projet où le vivant et le monde agricole avancent ensemble.
« On veut mettre notre pierre à l’édifice, agir dans l’intérêt de tout le monde – biodiversité, agriculteurs et habitants. On peut être tous gagnants à court, moyen et long terme. », précise Timothé Crionay, maire de Saint-Victor sur Rhins.
Portée par la commune et la fédération de chasse, la démarche s’appuie sur une évolution progressive de la gestion des haies et une cartographie des haies. Elle redonne aux haies leur rôle écologique tout en développant des usages agricoles et économiques concrets.
Pour les agriculteurs, les bénéfices sont multiples :
- Les haies agissent comme brise-vent et brise soleil, protègent les cultures et contribuent à créer un microclimat plus stable sur les parcelles, bénéfique notamment au bétail.
- Elles participent également à la santé des sols : en limitant l’érosion, en protégeant les ressources en eau et en restaurant la fertilité des terres.
- La taille raisonnée permet aussi de produire des copeaux de bois utilisés pour la litière animale, durable, qui améliore le confort et la propreté des animaux et représente une économie pour les exploitations.
« On avait des parcelles ayant besoin de haies. On a remis ce qui avait disparu. En trois ans, on a recréé un kilomètre de haies. Elles protègent les sols, créent des séparations naturelles, de l’ombre pour les vaches, et la biodiversité revient. Il y a de l’entretien à faire, mais ça vaut vraiment le coup. », témoigne Dominique Damais, agriculteur participant à l’expérimentation.
La haie redevient ainsi un outil multifonction, au service des exploitations et de l’environnement. Réservoir de biodiversité, elle favorise la régulation naturelle des ravageurs et le retour de la faune.
L’éco-hameau de Burdignes : habiter sobrement pour vivre pleinement
À Burdignes, petite commune de moyenne montagne dans la Loire, la municipalité a lancé dès 2006 un projet d’écohameau à taille humaine. L’objectif : proposer des logements accessibles, peu énergivores et respectueux de l’environnement, tout en préservant les terres agricoles, ressource précieuse dans ce territoire d’élevage. Un pari audacieux, pensé à long terme, qui porte aujourd’hui ses fruits.
La municipalité a ainsi acquis un hectare de plantation de résineux pour y aménager 11 parcelles : 10 maisons individuelles et une maison commune. Une partie du terrain accueille également un verger et un potager partagés. Chaque maison doit répondre à un cahier des charges imposant l’usage d’au moins un matériau biosourcé ou géosourcé (paille, terre, pierre…) ainsi qu’une source d’énergie renouvelable.
« Je suis arrivé à Burdignes en 2015 pour rejoindre ce projet vivant. En tant qu’ancien agriculteur, c’était une chance pour moi de construire une maison confortable et économe en énergie, où je vais pouvoir vivre dignement avec ma petite retraite. », précise Philippe Heitz, habitant du hameau et maire de Burdignes
Les habitants ont conçu leur maison respective avec une grande liberté architecturale, dans un esprit de mutualisation. Toutes sont finalement en ossature bois, bien isolées, orientées sud pour capter l’énergie solaire. La maison commune va accueillir une grande salle multiusage et des hébergements pour les familles ou amis.
« Ma facture annuelle de chauffage et d’eau chaude est de 40 euros ! Ce type de construction est économiquement très avantageux dans le temps, avec un coût initial comparable à celui d’une maison classique. »
Ce projet montre qu’il est possible de proposer des logements durables, confortables et abordables, tout en favorisant la convivialité et les usages partagés. Il constitue une réponse concrète aux risques de précarité énergétique et à la désertification rurale.
« C’est une piste d’avenir pour tous les âges. Cela pourrait permettre de loger des jeunes qui souhaitent revenir ou rester au village, de maintenir des actifs et des retraités, de faire vivre nos campagnes. Ce projet peut vraiment en inspirer d’autres, notamment des bailleurs sociaux avec des impacts sociaux à large échelle. »
L’écohameau de Burdignes incarne un choix local fort : construire autrement, pour mieux vivre ensemble, à coût maîtrisé, dans le respect du territoire et de ses ressources.
Le Sylvetum de Marols : Une forêt expérimentale pour demain
À Marols, petit village médiéval de caractère niché à 900 mètres d’altitude dans le Haut-Forez, (Loire), un projet forestier inédit prend racine : le Sylvetum. Porté par la commune en partenariat avec l’ONF et le CNPF, ce site expérimental de 8 hectares a pour vocation d’anticiper l’avenir des forêts face aux bouleversements climatiques.
« Nos forêts souffrent, et nous cherchons des solutions durables. Il s’agit d’observer, de comprendre, mais aussi de sensibiliser. Le projet de Sylvetum fédère, prend du sens au sein du territoire », explique Christophe Dubost, maire de Marols.
Sur les hauteurs du Bois Gaulois, 2 760 arbres de 24 essences différentes ont été plantés entre novembre 2024 et mars 2025. Les espèces sélectionnées – provenant notamment de Turquie, de Californie ou du bassin méditerranéen – sont testées pour leur capacité à s’adapter au climat
du Forez. L’objectif : étudier leur adaptation aux conditions nouvelles et leurs interactions avec les essences locales.
Les premières années sont déterminantes. Pour assurer la réussite des plantations, une couverture végétale d’au moins 80 % doit être maintenue. Ainsi des journées participatives ouvertes à tous sont organisées à partir de l’été 2025 autour de l’entretien.
Mais le Sylvetum est aussi un formidable outil de sensibilisation. Un parcours pédagogique pour petits et grands, un belvédère offrant une vue imprenable sur la vallée et le Mont-Blanc, et une classe en plein air accueillent désormais élèves, promeneurs et curieux au cœur de la forêt.
« Pour les enfants, le Sylvetum, c’est un peu une extension de leur cour de récréation », sourit Christophe Dubost. Labellisée Développement durable (niveau 2), l’école du village est impliquée depuis le début. Et désormais, toutes les classes du département – du CP au CM2 – peuvent découvrir ce lieu à travers des journées pédagogiques encadrées.
Chaque enfant né à Marols entre 2020 et 2026, ainsi que ceux du club de football local, a désormais un arbre à son nom. Certains viennent l’arroser, gourde à la main : de véritables ambassadeurs de la forêt de demain.
Un financement participatif permet à chacun de parrainer un arbre et de voir son nom gravé sur un médaillon à l’entrée du site. Un geste concret et symbolique, pour faire pousser l’avenir.
À Marols, le Sylvetum conjugue science, environnement et pédagogie, tout en contribuant à l’attractivité du village. Une transition écologique enracinée dans le vivant et dans son territoire.

La méthanisation au cœur d’un projet territorial pour une énergie agricole, locale et durable
À Saint-Denis-sur-Coise, une dynamique collective a permis de transformer un ancien terrain agricole de 14 hectares en une ZAC mêlant entreprises locales, énergies renouvelables et agriculture durable.
Depuis 2012, la commune et un groupe d’agriculteurs engagés ont œuvré main dans la main pour faire émerger un projet ambitieux de méthanisation territoriale.
« Ce projet, nous l’avons pensé sur le long terme : pour valoriser nos ressources, créer de l’énergie renouvelable et renforcer l’économie locale. », explique Daniel Bonnier, maire de Saint-Denis-sur-Coise.
Le méthaniseur, installé sur la commune, est le fruit d’une coopération entre une douzaine d’agriculteurs regroupés en SAS, soutenus par le SIMOLY et associés aux collectivités via la SEM Soleil et le fonds régional OSER.
Mis en service en 2020, le site traite chaque année 24 000 tonnes de matières organiques issues du territoire : 60% d’effluents d’élevage provenant d’exploitations situées dans un rayon de 5 km, et 40% de biodéchets collectés auprès d’entreprises agroalimentaires locales et de cantines scolaires. Ces déchets sont transformés en énergie renouvelable (biométhane), injectée dans le réseau local de gaz, avec une production annuelle de 14 GWh.
Le résidu, appelé digestat, est également valorisé sur les terres agricoles des éleveurs participants et agriculteurs alentours, permettant de réduire l’usage d’engrais de synthèse.
Ensuite, à l’initiative de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, une station bioGNV 100 % renouvelable a été menée. Cette station alimente désormais les bus scolaires, les camions-bennes de la collectivité, les transporteurs locaux et des véhicules légers. Ce biocarburant émet 80 % de CO₂ en moins qu’un diesel équivalent, sans particules fines.
“ À partir de septembre 2025, tout le CO₂ sera valorisé grâce à un liquéfacteur. Le projet continue de se développer et à créer de l’activité sur le territoire.”, souligne AloÏs Klein, éleveur et président de Méthamoly.
« À terme, nous souhaitons amener le gaz jusqu’au bourg, à un kilomètre, pour chauffer les bâtiments publics et les foyers intéressés », précise Daniel Bonnier, maire de Saint-Denis-sur-Coise.
Ce projet innovant incarne un modèle énergétique sobre, coopératif et ancré dans son territoire, qui s’appuie sur la force du collectif, l’innovation agricole et la valorisation locale des ressources.

La filière trufficole dans le Beaujolais : un renouveau au service des agriculteurs et du terroir
Face à la déprise agricole, en particulier viticole, le Beaujolais innove en diversifiant ses cultures grâce à la relance d’une filière trufficole locale. Ce projet ambitieux vise à apporter de nouvelles sources de revenus aux agriculteurs, en développant une culture adaptée aux évolutions climatiques. Comme le souligne un trufficulteur : « C’est un projet très complet mêlant agroforesterie, terroir et patrimoine gastronomique. Les truffes, c’est tout un univers ; c’est un produit extraordinaire, qui existe de manière naturelle dans les Pierres Dorées. Nous sommes un groupe de passionnés, constitué depuis 2015. »
Le Beaujolais, mondialement réputé pour ses vins, cache en effet un trésor méconnu : la truffe, ce fameux « diamant noir » qui s’épanouit dans les sols calcaires et argileux caractéristiques des Pierres Dorées, de Saint-Germain-Nuelles à Chessy, Theizé, Denicé ou Montmelas. La présence de la truffe dans la région remonte au XVIe siècle ; relancer cette production permet ainsi de perpétuer un précieux héritage agricole et gastronomique.
Michel Vidal, précurseur du projet, a planté des chênes truffiers dès 1995, et d’autres l’ont rejoint dans cette initiative, qui a conduit en 2015 à la création de l’Association des trufficulteurs du Beaujolais des Pierres Dorées. L’objectif est de relancer la production de truffes de Bourgogne avec passion, sans prétention, en partageant les savoir-faire.
Aujourd’hui, plusieurs dizaines d’agriculteurs participent à cette aventure, plantant des centaines d’arbres truffiers, principalement des chênes. Si la production reste modeste et ne permet pas de satisfaire la demande, elle s’inscrit dans une logique de diversification agricole complémentaire. La monoculture n’étant pas viable dans la région, la truffière a une durée de vie d’environ 25 ans, après quoi les arbres peuvent être valorisés en bois de chauffage.
La réussite de l’implantation des truffières repose en grande partie sur la qualité des sols, tandis que l’utilisation de chiens truffiers, spécialement dressés pour détecter les truffes, garantit une récolte précise et respectueuse du sol.
« Cette filière trufficole est une formidable opportunité pour notre territoire. Elle contribue à préserver nos paysages, enrichir notre agriculture, et valoriser notre patrimoine gastronomique. Soutenir nos agriculteurs dans cette diversification est essentiel pour préparer l’avenir face aux défis climatiques. » insiste Mr Christian Vivier-Merle, le maire de Theizé.
Au-delà de la production, l’association place la transmission au cœur de ses priorités : accompagner les nouveaux membres de la plantation jusqu’à la récolte, organiser des rencontres et promouvoir la truffe locale auprès des restaurateurs, afin de faire rayonner le Beaujolais sous un nouveau jour.
Grandris réinvente sa place des Platanes : un espace durable alliant convivialité et écologie
À Grandris, commune du Beaujolais Vert, la place des Platanes a connu une transformation en profondeur. Anciennement bitumée sur 3 000 m² et occupée principalement par un parking, cette vaste esplanade bordée de platanes a été repensée pour devenir un véritable lieu de vie, écologique et convivial.
L’équipe municipale a engagé une démarche exemplaire de désimperméabilisation, permettant de libérer 2 500 m² de sols, de créer des noues végétalisées pour la gestion douce des eaux pluviales, et d’installer une cuve de récupération de 10 m³ afin d’alimenter l’arrosage des espaces publics. Cette approche a reçu le soutien de l’Agence de l’Eau, en reconnaissance du travail mené autour de la gestion durable de l’eau.
Treize nouveaux arbres ont été plantés, accompagnés de plus de 500 végétaux (arbustes, plantes herbacées). Une partie de la place a été ré-engazonnée, redonnant de la fraîcheur et de la biodiversité au cœur du village. Le mobilier urbain a été réalisé avec soin par un artisan local.
Au-delà de l’aspect paysager et écologique, c’est l’usage de la place qui a été au centre du projet. Chaque jeudi matin, le marché local s’y installe, accueillant producteurs et habitants, autour d’une offre variée en alimentation de proximité et en circuit court. Pour renforcer cet ancrage, une halle ouverte a été construite : à la fois abri pour le marché, lieu d’exposition, buvette associative et salle hors-sac. Elle s’intègre parfaitement dans la pente du site et relie harmonieusement la mairie à la place.
Le rez-de-chaussée accueille en particulier un café associatif animé par les habitants, comme le club des anciens, contribuant à faire de cette place un espace intergénérationnel et dynamique.
« Nous avons voulu faire de cette ancienne place de parking un lieu de vie, de rencontre et de convivialité. Désimperméabiliser, replanter, récupérer l’eau de pluie… chaque geste compte pour rendre notre village plus résilient. Et surtout plus vivant. »
— Pascale Jomard, maire de Grandris
Ce projet ambitieux, mené avec les habitants et acteurs du territoire, témoigne d’une volonté forte : redonner sens et usage aux espaces publics, en misant sur l’écologie, le lien social, les circuits courts et la qualité architecturale.
Réseau de chaleur à Montrottier : une commune engagée pour une énergie locale et durable
À Montrottier, la transition énergétique ne relève plus du discours, mais bien de l’action. Depuis octobre 2023, la commune s’est dotée d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur qui alimentent aujourd’hui l’ensemble de ses bâtiments publics, mais aussi plusieurs logements privés, la maison de santé et le restaurant du village.
Un projet ambitieux porté avec l’appui du Syder (Syndicat d’énergies du Rhône), qui illustre de manière exemplaire la volonté de sortir des énergies fossiles au profit d’une ressource locale et renouvelable : le bois.
« Nous voulions en finir avec la dépendance au fioul, au gaz et à l’électricité, tout en construisant un modèle plus stable, plus écologique et plus équitable. Ce projet est un investissement sur le long terme, à la fois économique et environnemental », explique Michel Goujet, maire de Montrottier. « C’est aussi une démarche volontariste : prouver qu’une petite commune peut faire sa part, concrètement, pour le climat. »
Située à proximité immédiate du centre-bourg, la chaufferie bois fonctionne avec des copeaux issus des forêts du Beaujolais vert. Ce choix permet de soutenir directement les forestiers locaux et valorise une ressource renouvelable de proximité.
Elle alimente un réseau de chaleur de 1,4 km, l’un des plus importants du département hors Métropole. Les bénéfices sont tangibles ; les factures énergétiques allégées — jusqu’à 100€ par mois en moins pour certains habitants — et une facture carbone considérablement réduite. Au-delà des économies d’énergie, ce système apporte un confort thermique notable aux usagers, en particulier aux personnes âgées, qui bénéficient d’une chaleur constante et homogène.
Derrière cette réussite collective, on retrouve la volonté de bâtir un système pérenne. Le coût du kilowattheure est compétitif, et sa stabilité contraste avec les hausses récurrentes des énergies classiques. Grâce à un amortissement sur 25 ans, le dispositif garantit une énergie durable, accessible et non-fluctuante.
L’inauguration du réseau, en mai dernier, a rassemblé élus locaux, représentants de l’État et habitants, tous venus saluer une initiative qui inspire déjà d’autres communes. Car le réseau de chaleur de Montrottier est évolutif : les particuliers proches du tracé peuvent encore s’y raccorder.
Une belle manière d’allier engagement local, cohésion territoriale et action climatique, tout en réchauffant, concrètement, le cœur du village !